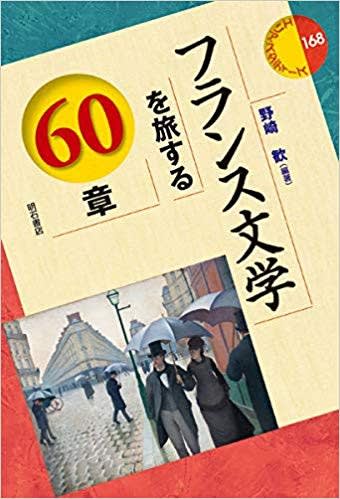Administrateur du domaine de George Sand à Nohant-Vic pendant plus de dix années, Georges Buisson fait paraître "George Sand en ses jardins", un ouvrage comme une invitation à découvrir un lieu inspiré, une vision de la nature, et « l'humanité d'une femme ». Entretien.
George Sand n'a pas été considérée, au XXe siècle, comme une figure littéraire, politique, majeure. Son œuvre, sa personne, le domaine de Nohant, sont aujourd'hui des objets d'étude. Pourquoi un tel revirement?
Le XXe siècle n'a pas été très tendre, en effet, avec elle. Quand je suis devenu administrateur du domaine de George Sand en 2000, je me suis plongé dans l'univers de George Sand. Jusque là, je ne la connaissais pas ou peu, ou bien comme la majorité des gens la connaissent, c'est-à-dire de manière parcellaire. J'étais plus attiré par Colette ou Marguerite Duras, deux écrivaines que j'affectionne. J'ai vraiment appris à connaître George Sand à ce moment là et je me suis rendu compte que le XXe siècle avait été profondément injuste à son égard.
Comment l'expliquez-vous?
La première raison, c'est qu'après sa mort, il a fallu rendre cette femme, qui avait un peu défrayé la chronique de son vivant, « respectable ».
La première biographie qui lui a été consacrée, dix ans après sa mort, a été rédigée par un éminent académicien, Edme Caro. Celui-ci est venu à Nohant, a rencontré George Sand. Dans les cinquante premières pages de son livre, il explique à quel point George Sand est un monument de la littérature, combien elle écrit bien. Les pages suivantes sont consacrées, en revanche, au reproche de son engagement politique. D'après lui, il s'agit là d'une errance totale : il la décrit comme une femme influencée, influençable. Selon lui, à part les romans dits champêtres (il est le premier à employer l'expression), le reste de son œuvre mérite d'être mis de côté car il est entaché par l'idéologie socialiste de Pierre Leroux, par les engagements de Michel de Bourges. Edme Caro gomme ainsi un des aspects fondamentaux de l'œuvre de George Sand : l'engagement politique et social. Si on ne le connaît pas, on passe à côté de l'œuvre.
Georges Buisson
Le deuxième point, c'était qu'il fallait gommer la femme libre, celle qui disait dans une grande honnêteté qu'elle avait des amants, des grandes histoires d'amour : avec Musset, avec Chopin, Michel de Bourges, et le grand amour de la fin de sa vie, Alexandre Manceau, l'amour de la sérénité. Elle osait revendiquer l'amour dans sa pureté. Mais elle était aux yeux de certains la femme scandaleuse, celle qui fumait, qui s'habillait en homme... Quand on lit les articles de cette époque sur George Sand, la violence est inouie.
Pour ces gens qui rejettaient la femme libre, il fallait la « rattraper ». Pour cela, on a mis en avant la grand-mère exemplaire qu'elle était, celle qui faisait les confitures. On a ainsi fait de George Sand la « bonne dame de Nohant ».
Dans ce contexte, on aurait pu se dire qu'elle sera soutenue, promue par le camp des progressistes. Pas du tout.
Pour quelle raison?
On lui en a beaucoup voulu pour son incompréhension et son rejet de la Commune. Et à elle plus qu'à d'autres, parce qu'elle était une femme. Et une femme qui avait l'outrecuidance de se mêler de politique, cela dépassait l'entendement. George Sand était profondément pacifiste. Elle avait cette très belle phrase : « il faut être révolutionnaire toujours, terroriste jamais ». C'est très fort... Elle a été vue par les progressistes comme une bourgeoise opportuniste dont la seule ambition était de préserver les siens et ses intérêts.
Le mouvement féministe des années 1960-1970 a-t-il défendu George Sand?
Pas du tout ! On aurait pu le penser... Mais Simone de Beauvoir a eu un jugement très dur envers George Sand, considérant que son attitude par rapport à la libération de la femme était trop timorée.
Non seulement George Sand n'a été défendue par aucun des mouvements sociaux, mais en plus, son œuvre n'a jamais été choisie comme sujet à l'agrégation de lettres. Jamais. On a considéré que son œuvre était mineure, secondaire. En partie parce qu'elle osait dire qu'elle avait une grande facilité pour écrire. L'idée qu'elle puisse avoir une facilité à écrire, à produire une œuvre qui ne naît pas de la douleur, comme l'enfantement, la faisait paraître comme peu digne de respect.
Michelle Perrot écrit sur George Sand et Nohant : « Cela m’a fait penser à la Cerisaie, une Cerisaie berrichonne »
Il a fallu attendre 2004, l'année du bicentenaire de sa naissance, pour que l'on commence à corriger ces injustices. Michelle Perrot a été une des premières à le faire puisqu'elle a réuni tous les textes politiques de George Sand dans un très beau livre, Politique et polémiques. D'autres ouvrages mettant en avant cet engagement lui ont succédé. On a fait en sorte en 2004 de mettre en avant la femme républicaine, engagée.
Pour George Sand, ce qui comptait, c'était de réfléchir, de penser, de confronter ses idées. Elle avait fait de Nohant une sorte de cénacle permanent, où le brassage des idées se faisait. On expérimentait la musique, la botanique, la peinture, on était intéressé par tout, on était passionné.
Vous montrez que la renaissance de la figure de George Sand est passée par son engagement. Le site de Nohant n'a-t-il pas été également un pilier dans cette nouvelle manière de la regarder?
Bien sûr. George Sand était une utopiste. Sur la politique, elle disait par exemple : « la passion de la politique, je ne l'aurai jamais. Je n'ai que celle des idées ». Pour elle, ce qui comptait, c'était de réfléchir, de penser, de confronter ses idées. Elle avait fait de Nohant une sorte de cénacle permanent, où le brassage des idées se faisait. On expérimentait la musique, la botanique, la peinture, on était intéressé par tout, on était passionné.
https://www.leberry.fr/bourges/loisirs/art-litterature/2018/11/03/georges-buisson-le-jardin-de-nohant-a-toute-la-poesie-des-defauts-humains_13035836.html